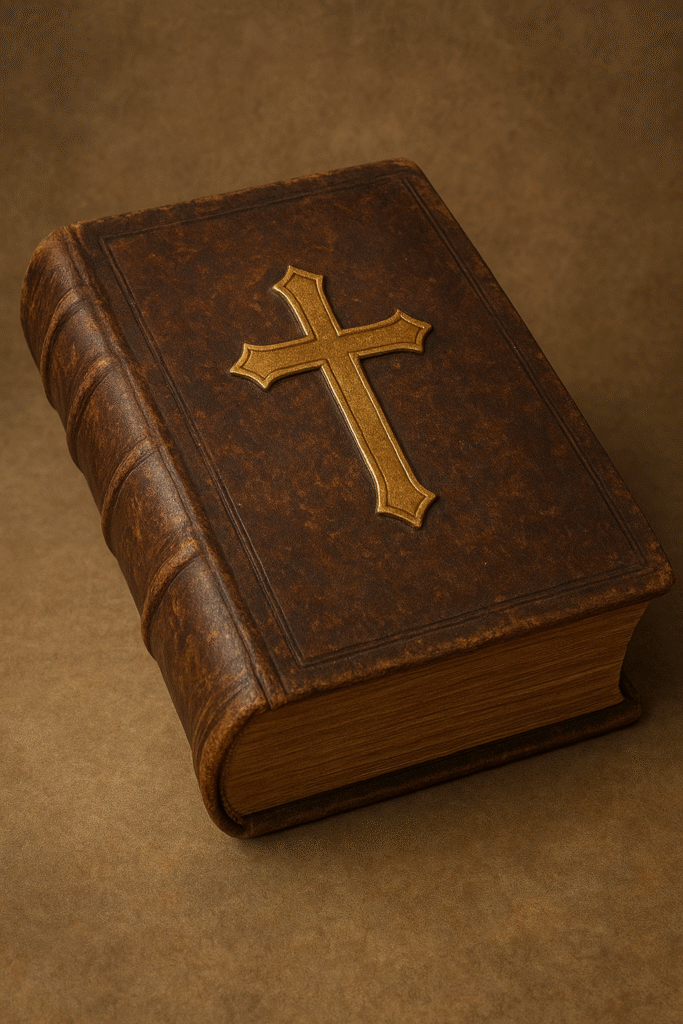L’histoire de la Bible permet de comprendre une grande partie de la culture, de la spiritualité et de l’histoire du monde occidentale. Le mot « bible » vient de « biblia », qui signifie « les livres ». La Bible est en réalité une bibliothèque composée de textes de genres très variés : récits historiques, lois, poèmes, prières, prophéties, lettres, récits symboliques et apocalyptiques. La Bible n’est pas seulement un document religieux, c’est aussi un témoignage historique, un texte littéraire et une source symbolique profonde. Elle a influencé la philosophie, l’art, la littérature, le droit et la pensée occidentale. Les lectures symboliques (allégoriques, mystiques) sont nombreuses, en particulier dans les traditions chrétiennes et juives.
La Bible se divise en deux grandes parties :
-L’Ancien Testament (ou Tanakh pour les juifs)
-Le Nouveau Testament (propre au christianisme)
L’Ancien Testament
Ces textes ont été rédigés entre le XIIème siècle et le IIème siècle avant JC. Ils racontent l’histoire du peuple d’Israël, ses alliances avec Dieu, ses lois, ses rois, ses prophètes, ses exils…
Le Nouveau Testament (ou Seconde Alliance)
Il a été rédigé au Ier siècle après JC, entre 50 et 100 apr JC. Il témoigne de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que de la naissance du christianisme. Il contient les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les Actes des apôtres, les Épîtres (principalement de Paul, mais aussi de Jacques, Pierre, Jean, Jude), l’Apocalypse, qui est une vision prophétique de Jean.
La formation du canon biblique
Le « canon » désigne la liste officielle des livres reconnus comme inspirés. Pour les juifs, le canon du Tanakh a été fixé cers le Ier ou le IIème siècle après JC. Pour les chrétiens, le Nouveau Testament a été progressivement reconnu dans les premiers siècles, avec des débats jusqu’au IVème siècle. La Bible présente des différences selon les traditions : celle des catholiques comporte 73 livres (incluant les deutérocanonique) ; la Bible des protestants comprend 66 livres (les deutérocanoniques ne sont pas inclus) et celle des orthodoxes a un canon un peu plus large que celle des catholiques. La « Septante » est le nom de la traduction grecque de la Bible hébraïque (IIIème siècle après JC) ; la « Vulgate » est la traduction latine de Saint Jérôme, effectuée au IVème siècle après JC et qui a été la référence pendant des siècles en Occident. Des traductions modernes ont été réalisées dans des centaines de langues, dont la Bible de Luther (en allemand), King James (version anglaise), ou la Bible de Jérusalem (français).
Les influences historiques et culturelles majeures
Le Proche-Orient ancien
La Bible, surtout l’Ancien Testament, s’inscrit dans le contexte du Proche-Orient ancien, entre l’Égypte, la Mésopotamie, le Levant et canaan.
Certains récits de la Bible présentent des similitudes avec des récits mythologiques des civilisations mésopotamienne, égyptienne, babylonienne, cananéenne.
Quelques exemples :
Le mythe du Déluge de l’épopée de Gilgamesh (Mésopotamie) est très proche du récit de Noé dans la Genèse.
La création de l’homme à partir de la glaise (Sumer, Mésopotamie) se retrouve dans la Genèse.
Le Code d’Hammurabi (Babylone, XVIIIème siècle) a des similitudes avec les lois bibliques (dans l’Exode, le Lévitique).
Certains psaumes et symbole (comme le chaos vaincu par Dieu) rappellent les combats cosmogoniques égyptiens et cananéens.
Des influences religieuses et spirituelles
Le judaïsme ancien se distingue progressivement des religions polythéistes environnantes. Cette évolution est lente et ne s’impose qu’après l’exile à Babylone (VIème siècle avant JC). Avant l’exil, des traces d’influences polythéistes persistent : l’Ancien Testament mentionne d’autres dieux ainsi que des pratiques païennes mentionnées par les prophètes. C’est au cours de leur exil à Babylone que les élites israélites ont découvert les cosmologies babyloniennes et l’organisation religieuse mésopotamienne. Cet exile a provoqué une crise spirituelle qui a incité les hébreux à rédiger et structurer les traditions orales et alors est née une grande partie de la Bible hébraïque telle qu’on la connaît.
Des influences grecques (hellénistiques)
Après la conquête d’Alexandre le Grand (IVème siècle après JC), la culture grecque imprègne tout le Proche-Orient. L’influence de la philosophie grecque, avec notamment le dualisme corps/esprit va influencer certains textes bibliques tardifs, notamment la Sagesse de Salomon ou l’Évangile de Jean. La traduction de la Bible en grec (la « Septante »), va intégrer des sensibilités grecques et rendre accessibles les textes hébraïques à un public plus large. La langue grecque es la langue du Nouveau Testament et elle était parlée dans tout l’Empire, même en Judée. Les structures des lettres (épîtres de Paul, Pierre) suivent la forme des lettres grecques classiques.
Influences romaines et juives dans le Nouveau Testament
Jésus vivait en Judée, qui était sous occupation romaine. La société de cette époque était traversée par des tensions entre des factions qui collaboraient avec les romains (roi Hérode, sadducéens) et les opposants à l’occupation romaine (zélotes). Des courants religieux juifs variés se côtoyaient dans la région : les pharisiens, les esséniens, les sadducéens, chacun avec une vision du monde différente. Les romains toléraient la religion juive mais ils attendaient la soumission politique et le paiement des impôts. La présence romaine en Judée était incarnée par les gouverneurs, comme Ponce Pilate, la roi Hérode (un roi juif vassal de Rome), les soldats romains et leur autorité militaire. Les romains étaient vus comme des oppresseurs mais Jésus ne prônait pas la révolte politique.
Jésus le juif
Jésus était juif, comme tout ses disciples et le Nouveau Testament est rempli de références à l’Ancien Testament (appelé Tanakh dans la tradition juive). Jésus enseignait dans les synagogues, commentait la Torah, célébrait les fêtes juives, respectait la Loi, tout en la réinterprétant. Pour donner quelques exemples, la Pâque est devenue le cadre de la Cène, le sermon sur la montagne évoque Moïse au Mont Sinaï, Jésus citait souvent les prophètes de l’Ancien Testament. Des textes comme l’Apocalypse de Jean ou certains passages de l’Évangile de Marc reprennent des codes d’écriture issus de la tradition juive apocalyptique. Le judaïsme de l’époque était marqué par une forte espérance messianique ; un libérateur politique et spirituel était attendu, toutefois Jésus revendiquait une messianité différente : un serviteur souffrant, non violent, un roi paradoxal. C’est cette déception face à un messie qui n’incarnait pas la puissance capable de chasser Rome et qui était vu comme un fauteur de troubles qui a en partie expliqué la crucifixion de Jésus.
Des influences philosophiques et symboliques
Certains textes reflètent une pensée dualiste entre lumière et ténèbres, bien et mal, corps et esprit, qu’on retrouve aussi dans le zoroastrisme perse ou chez le philosophe Platon. La Bible mobilise de nombreux archétypes universels : la jardin (Éden), le serpent, le déluge, le combat contre le chaos ou le dragon, la traversée du désert, le passage de la mer (initiation), la montagne (lieu de la Révélation). Ces symboles forment un langage profond qui parle à l’inconscient collectif. Ces symboles parlent de réalités intérieures, spirituelles, essentielles. La Bible met en scène des personnages universels, dont les récits touchent à l’expérience humaine fondamentale. Il est possible d’établir des correspondances entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament : par exemple, Moïse préfigure Jésus, l’agneau pascal préfigure la crucifixion, le passage de la mer évoque le baptême.
La Bible est donc à la croisée de la philosophie, du mythe et du symbole. Elle n’est pas seulement un récit historique et religieux, mais un texte vivant qui parle à la raison comme à l’imaginaire, à l’esprit comme à l’inconscient. Elle dialogue avec les grandes pensées de son temps, tout en construisant un langage symbolique propre, porteur de sens à travers les siècles.